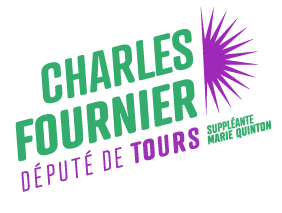Je profite des regards tournés vers la folie trumpiste et ses dérivés numériques pour coucher ici quelques pensées sur l’état du débat public en France. Le climat politique, saturé d’anathèmes, de punchlines, de surenchères et de clash, est devenu de plus en plus irrespirable. L’esprit étouffe, et la démocratie avec lui.
J’évoque souvent mon indisposition face à cette dégradation du débat public et à l’affaiblissement de la délibération collective, centrale dans toute démocratie. Je repense à l’introduction par Giuliano da Empoli de son essai Les Ingénieurs du chaos : il y décrit le Carnaval comme un grand moment de renversement de toutes les hiérarchies et de toutes les normes, où les intermédiations s’effondrent. Il poursuit, regardant le monde contemporain : « le Carnaval a finalement abandonné sa place préférée, aux marges de la conscience de l’homme moderne, pour acquérir une centralité inédite, se positionnant comme le nouveau paradigme de la vie politique globale ». Et de poursuivre en tirant ce fil, montrant que ce moment populiste hisse au pouvoir les droites les plus réactionnaires.
Ces derniers temps, la tonalité du débat public sonne de la même manière. Fort mais souvent creux. Cela doit nous interroger. Une étude1 s’est plongée sur la transformation des débats à l’Assemblée nationale, analysant 2 millions d’interventions entre 2007 et 2024. Elle a été un peu commentée mais vite reléguée loin derrière l’actualité frénétique. Et pourtant, je crois que nous aurions tout intérêt à nous pencher sur ce qu’elle révèle.
Généralisation de la colère, disparition des arguments, chute de la durée des interventions (pour les faire tenir dans le format vidéo cher aux réseaux sociaux) … la moitié des prises de parole ne sont plus que des interruptions. Et ce constat : « les députés ne parlent plus, ils hurlent ». Je pourrais même ajouter : ils ne se parlent plus, ils parlent vers l’extérieur. Aux premières loges dans l’hémicycle, je le constate à chaque fois. Nous ne nous entendons plus (mais essayons-nous encore de nous écouter ?) et les arguments disparaissent, chassés par les invectives. Je sais que je n’échappe pas totalement à ce mouvement général. Quand une norme change, il est difficile de ne pas l’épouser. Surtout quand la polémique devient un chemin obligé pour se rendre audible. Ainsi vient le schéma vicieux : les mêmes scènes se reproduisent, rejouées sur les mêmes plateaux télé, qui délivrent les mêmes commentaires.
Je sais que les débats parlementaires ont déjà été houleux dans l’histoire. Beaucoup gardent en mémoire le dernier duel à l’épée provoqué par René Ribière, insulté la veille par Gaston Defferre au Palais Bourbon. C’était le 27 avril 1967, autant dire hier. Le virilisme fait malheureusement partie de l’histoire parlementaire, et il gangrène encore aujourd’hui nos débats. Je sais aussi qu’il y a des colères saines et des emportements légitimes face aux provocations d’un pouvoir qui foule aux pieds la démocratie et les urgences écologique et sociale. Mais il ne s’agit pas (que) de cela.
On entend en boucle, que l’hémicycle serait aujourd’hui « bordélisé » et que ce serait le résultat d’une tare politique d’un seul camp. Les droites et l’extrême droite s’allient d’ailleurs pour dire cela avec constance. Trop simple de se contenter de cette explication.
Il se noue autre chose aujourd’hui. La séance hebdomadaire des Questions au Gouvernement ne se joue plus à l’Assemblée mais sur les écrans de chacun, où les réseaux agissent comme unique caisse de résonance. Est-ce encore la démocratie, cette expérience rabougrie qui invisibilise les discours ne rentrant pas dans les canons algorithmiques ? Est-ce encore la démocratie, ce cloisonnement de la citoyenneté dans la figure de l’internaute, tantôt follower, tantôt hater ? Est-ce toujours la démocratie, cette absence totale d’intermédiation – et donc de respiration intellectuelle ?
Certes, il est devenu complexe de faire de la politique. Les électeurs sont difficiles à atteindre, ils ne lisent plus les tracts, ils ont la discussion rare et méfiante. Je vois aussi comment le label « vu à la télé » ou « liké sur Facebook » agit comme un effet multiplicateur pour la notoriété d’un.e député.e. Mais je m’inquiète de cette tendance à faire de la politique par et pour les réseaux sociaux.
Cela ne vient pas de nulle part. Emmanuel Macron a énormément abîmé la fonction parlementaire en transformant l’Assemblée nationale en chambre d’enregistrement. Depuis 2017, c’est le mépris qui prime. Et j’ai parfois, comme beaucoup de collègues, un vrai questionnement sur le sens de mon mandat. Quel est notre rôle si des réformes comme celle des retraites ne passent pas par le vote ? Si les 49-3 pleuvent, entre deux coups de menton de l’exécutif ? Je comprends alors la tentation renforcée d’exister hors de l’Assemblée, de lui préférer les réseaux et leurs millions de followers.
Je le dis souvent : dois-je finalement me consacrer davantage à la bataille culturelle plutôt qu’à la bataille législative puisque celle-ci est empêchée ? Au moins les réseaux sociaux permettent-ils une mesure quantitative de son action (les likes, ça se compte). Et parfois, un coup d’éclat ou une punchline bien servie peut affoler les compteurs voire même faire un bandeau sur BFM…
Si je comprends cette tentation, je ne m’y reconnais pas et je pense que nous devons profondément l’interroger.
Faire de la politique ne peut se résumer à animer des communautés. Notre mandat c’est de faire mûrir nos convictions et de les confronter au réel. De faire grandir les idées en les frottant à ceux qui ne pensent pas comme nous. C’est la vertu du débat public et de l’intelligence collective. Combien de fois ai-je pu changer d’avis au cours d’une audition ou d’une commission d’enquête ! En mettant nos mandats au service des algorithmes, en agissant comme de simples « relais d’opinion », nous dévitalisons notre fonction. Nous ne scions pas seulement la branche sur laquelle nous sommes, nous déracinons l’arbre.
Parce que ce dont les algorithmes se nourrissent, c’est le poison de la démocratie : caricature, mauvaise foi, brutalité. Le formatage des interventions entraîne celui des idées : en pensant slogans, on finit par agir en slogans. C’est un trait d’époque. Voir Bruno Retailleau sacrifier en un tweet l’accord franco-algérien de 1968 révèle combien la bêtise populiste s’installe aujourd’hui au plus haut niveau de l’État.
Je constate aussi comment le mensonge peut se faire passer pour la vérité quand il est prononcé au micro dans l’hémicycle sans qu’un véritable « fact-checking » ne permette d’éviter cette dérive. La théâtralisation qui a toujours existé prend là une tout autre tournure. La dramaturgie l’emporte trop souvent sur l’honnêteté et l’opposition des points de vue.
En tant que représentants du Nouveau Front Populaire, nous ne pouvons pas rester sourds à ces constats et aux critiques qu’ils ne manquent pas de générer. Victor Hugo le disait très bien : « la forme, c’est le fond qui remonte à la surface ». En liant notre destin à cette accélération sans limite, nous affaiblissons les principes mêmes d’existence de la gauche et des écologistes. Faudrait-il nous mouler dans le rythme ultra capitaliste, épuisant cognitivement, des réseaux sociaux ? Epouser un populisme 3.0 qui donne raison à l’antiparlementarisme ? Renoncer à parler au pays tout entier pour lui préférer la bulle informationnelle qu’offrent les algorithmes ?
L’étude que je cite plus haut nous apprend que le Rassemblement national, lui, fait tout l’inverse. Il a troqué ses habits de provocation pour le costume du notable. Il rassure. Même si sous couvert de cette notabilité apparente, leurs porte-paroles continuent d’utiliser les fake news, les approximations et nourrissent ainsi une nouvelle forme de populisme. Un populisme drapé de faux-semblants, le fond ne change pas.
Et pourtant il engrange dans l’opinion. Aujourd’hui, 51% des Français considèrent que le RN ne « représente pas un danger pour la démocratie en France ». Sur les plateaux télé comme dans les sondages, c’est le Nouveau Front Populaire qui unit contre lui. Je ne me remets toujours pas de cette inversion des courbes, de cette dédiabolisation de l’extrême-droite qui a croisé la détestation croissante de notre camp. Notre camp est celui de la réflexion, de l’analyse, du long-termisme. Nous sommes les défenseurs de la planification et de la 6ème République. Nous promouvons la science, l’éducation, les sciences humaines. Nous sommes le camp de l’émancipation, c’est-à-dire de tout ce qui élève les femmes et les hommes pour les extraire de leurs servitudes. Nous devons à tout prix lutter contre ce plafond de verre qui s’abat sur nous pour l’emporter dans les urnes. Cela suppose de valoriser tout le travail que l’on produit à l’Assemblée dans les missions d’informations, les enquêtes parlementaires, les auditions… et ne pas laisser les petites phrases et les tweets dicter l’actualité.
Que ce soit clair : il est des colères justes, et il est juste que la colère fasse aujourd’hui front à un pouvoir macroniste engoncé dans la production de malheurs sociaux, écologiques, démocratiques. Tout ce qui se joue à l’Assemblée n’est pas un spectacle. Mais je dis à mes collègues, je nous dis : attention à ne pas transformer ces colères en roues qui tournent sur elles-mêmes et deviennent du ressentiment. Parce que le ressentiment est un moteur de l’extrême-droite. Il nous faut au contraire travailler ces colères, leur donner une voie de sortie, soit de l’espoir et de la perspective. Il nous faut sortir de la politique-marketing pour donner à voir ce que serait un NFP aux commandes. Il nous faut incarner en actes cette dignité et cette intelligence que l’on veut porter à la tête du pays.
En une phrase : donnons à voir dès maintenant le changement que nous aspirons à rendre possible.
1 : Note de l’Observatoire du Bien-être n°2025-01 — La Fièvre parlementaire : ce monde où l’on catche ! Colère, polarisation et politique TikTok à l’Assemblée nationale | CEPREMAP. Chercheurs en sciences sociales de l’Université Paris 1, d’HEC et de l’Université de Zurich.
NB. : La question du maintien ou non sur X/Twitter est juste et légitime. Je me suis longtemps posé la question, puis j’ai fini par arbitrer pour rester sur ce réseau, tout en freinant drastiquement mes publications. Ma réflexion va se poursuivre. mais à ce stade je ne pars pas et pour trois raisons principales :
- Publier sur X/Twitter n’a aucune conséquence « extérieure » puisqu’en dehors de mon utilisation très occasionnelle, je ne publie rien en propre sur ce réseau (tous mes posts sont maintenant dupliqués simultanément sur Bluesky et ailleurs). Ce n’est pas, par exemple, comme aller sur CNews, qui implique d’offrir une certaine exclusivité à la chaîne.
- Si je dois quitter X/Twitter, faut-il que je quitte aussi Facebook/Instagram, dont le propriétaire s’est également rangé du côté de Trump et a eu des propos de haine ? On risque de ne pas s’en sortir (et c’est un problème, qui fera l’objet d’une prochaine note).
- Plus globalement, il me semble utile, en restant ou en quittant X ou d’autres réseaux sociaux, de poser aussi la question des usages des réseaux sociaux.