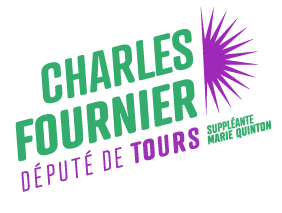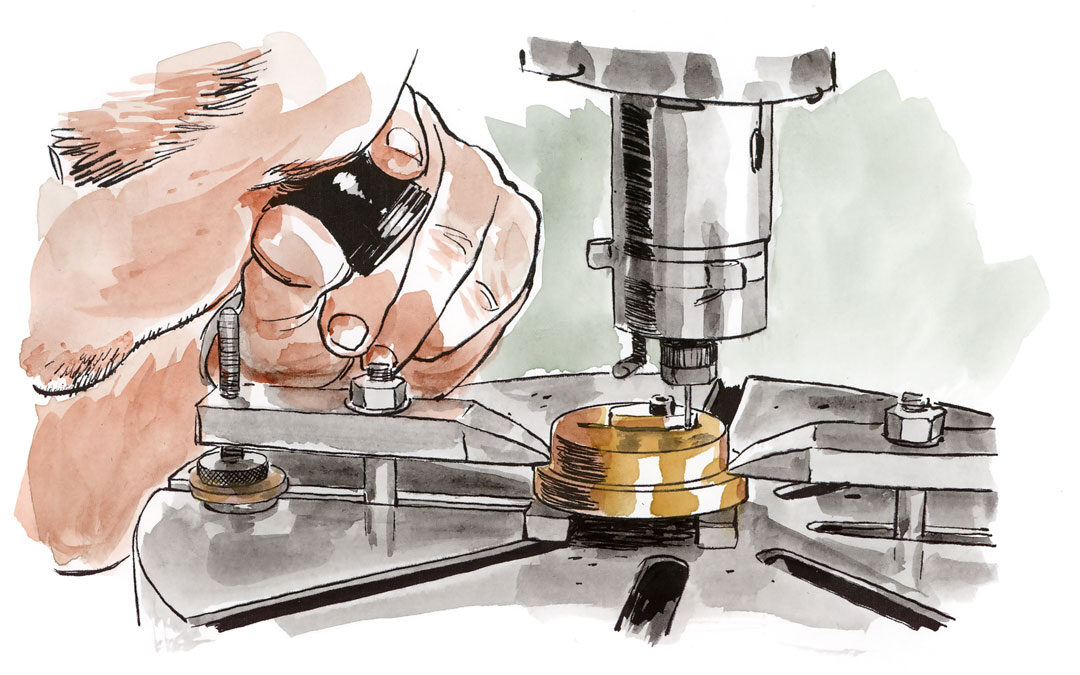En novembre 2023, le syndicaliste Charles Piaget s’éteignait à l’âge de 95 ans. Engagé lors du conflit social de l’entreprise d’horlogerie Lip située à Besançon dans les années 1970, il est une figure emblématique du mouvement autogestionnaire français. Alors que je me rends dans la capitale bisontine, le 13 décembre 2024, je pense à ce combat pour une industrie humaine, sociale, égalitaire et démocratique qui sonne juste à l’heure de ré-industrialisation ! Sur place, je retrouve ma collègue députée Dominique Voynet. Ensemble, nous allons rencontrer des entreprises implantées dans un territoire franc-comtois dynamique : ici, l’emploi ouvrier est nettement supérieur à la moyenne nationale (30 %), grâce à un tissu varié de PME sous-traitantes et une spécialité : la microtechnique.
Une industrie résiliente
Horlogerie, appareils photo, instruments de mesure… Grand Besançon accueille un pôle de compétitivité des microtechniques qui fédère les entreprises ayant ce savoir-faire. “Besançon et la Franche-Comté sont une terre d’industrie, confirme Anthony Poulin, adjoint à la maire écologiste Anne Vignot, qui nous accueille dans sa ville. “Cette activité s’inscrit dans une longue histoire du massif jurassien. Mes arrières grands-parents qui étaient paysans taillaient déjà des pierres ou du bois durant l’hiver, une activité artisanale de précision qui était utile pour les pivots en rubis des horloges ou la confection de pipe !” Aujourd’hui, la joaillerie de luxe fait la fierté des institutions de la ville qui tentent de construire une alliance locale avec les organismes de formation et les entreprises. “Bien sûr des filières entières ont été délocalisées avec la mondialisation, la lunetterie du Haut-Jura, par exemple, poursuit Anthony Poulin. Mais l’industrie bisontine est résiliente car nous fabriquons des pièces essentielles pour une multitude de donneurs d’ordre et différentes filières technologiques.”
Continuer de rendre attractif ces métiers est une source de préoccupation des industriels que nous rencontrons, pour préserver le savoir-faire, accroître leur activité et leur attractivité auprès des jeunes salariés. Au-delà de la microtechnique, ce terreau industriel local se renforce grâce à la production biomédicale et à la médecine du futur. Cette visite est également l’occasion de discuter des enjeux environnementaux : comme partout, nous nous interrogerons sur la compatibilité de ces activités industrielles, anciennes ou nouvelles, avec une trajectoire de transition écologique. Anthony Poulin attire notre attention sur la question cruciale et donc clivante de l’artificialisation des terres. “Toute la difficulté est de ne pas opposer les enjeux : industrialiser pour créer des emplois est un enjeu important mais la préservation des espaces naturels et les terres agricoles en est un autre. Comment faire cohabiter ces besoins et ces activités économiques ? C’est toute la question.”
Maîtriser le foncier : un enjeu de transition
Ce conflit d’usage nécessite de la concertation pour identifier collectivement, sur le territoire, de futures zones industrielles ou artisanales. Par exemple, là où des friches sont disponibles. “Aujourd’hui, on ne peut pas continuer d’appliquer le modèle d’il y a 10 ou 15 ans, et urbaniser à tout va. La maîtrise publique du foncier est un véritable outil pour mener une politique écologiste”, estime l’adjoint au maire. “Pour cette raison, on essaie d’entretenir un esprit de dialogue constant, avec les différents élus et les chefs entreprises, pour en débattre précisément et aborder les questions d’innovation, de transition écologique, sans esprit de compétition ou de concurrence.”
À l’usine Mondelez, leader mondial de la biscuiterie, des gâteaux par centaines sont fabriqués sous nos yeux sur les chaînes de production. Ils embaument le quartier de la Bouloie à Besançon et sont destinés à être vendus dans les paquets de différentes marques célèbres. Sur ce site, propriété d’un géant mondial de l’agro-alimentaire, une centaine de personnes viennent travailler chaque jour. Des efforts importants semblent être menés pour diminuer la consommation d’eau, réduire les déchets, changer de vecteur énergétique pour sortir des énergies fossiles ou encore se connecter au réseau de chaleur urbain. Les industriels sont attendus sur ces objectifs énergétiques de décarbonation. On sent bien que tout le monde s’y met, mais la transition nécessaire dépasse largement cet objectif. Les gâteaux suremballés, trop sucrés sont-ils vraiment soutenables ? “Impossible d’évoquer les risques pour la santé que peut engendrer la surconsommation de ces produits transformés”, constate à mes côtés Dominique Voynet. Pourtant, être en mesure de distinguer ce qui est essentiel du superflu, ou ce qui serait néfaste pour notre avenir, voilà tout l’enjeu d’une transition réellement verte de notre industrie !
Illustration : Titwane