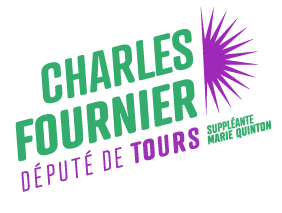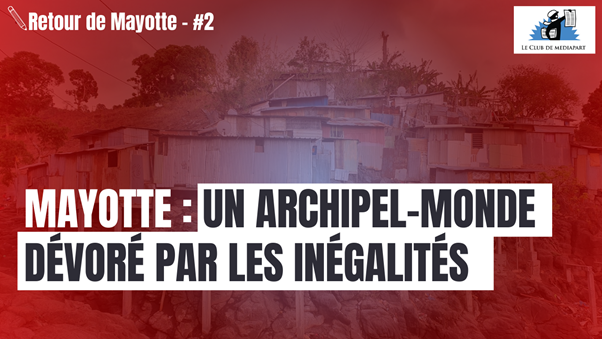De retour de mission parlementaire à Mayotte, j’ai entrepris une série de trois articles sur l’archipel. Le premier est à retrouver ici : https://blogs.mediapart.fr/charlesfournier/blog/070325/ep28-carnet-1-mayotte-un-archipel-meurtri-0
En réponse à la catastrophe Chido, le gouvernement tenait en un mot la raison de tous les malheurs : immigration. Le sous-investissement chronique de l’Etat ? Passé sous silence. Les défaillances en matière de prévention des catastrophes naturelles ? Mises en sourdine. C’est le discours martial de Bruno Retailleau qui a donné le la, repris en chœur par le pouvoir en place, jusqu’à cette odieuse phrase de Bayrou sur la « submersion migratoire ».
Parlons-en, de cette immigration. Il faut pour cela revenir à l’histoire de Mayotte, qui a toujours été intimement liée à ses îles et pays voisins. De par sa proximité avec Madagascar, son appartenance à l’archipel des Comores, Mayotte appartient à un ensemble géographique dont il est vain de vouloir l’isoler. Dans la vraie vie, celle qui n’est pas dans les notes de notre Ministre de l’Intérieur, les frontières sont parfois dérisoires face à la réalité des liens inter-humains et inter-culturels. Les Comoriens sont-ils vraiment des étrangers à Mayotte alors qu’il partagent la même culture, la même langue, la même religion, ont des liens de parenté et continuent à s’unir souvent par le mariage ? Alors forcément, cela se traduit par des circulations continues, d’hommes et de femmes, mais aussi d’argent, de produits, souvent illicites ou non-déclarés. Les échecs successifs des politiques visant à empêcher l’immigration et à durcir les conditions d’accès à la nationalité française doivent nous servir de leçon.
La réalité, pour l’avoir vue et touchée de manière sensible lors de mon séjour, est qu’il nous faut raisonner en région. Ne pas voir que Mayotte est un archipel-monde, c’est rater toute compréhension de ce territoire. Des Comores à La Réunion et l’île Maurice en passant par les pays côtiers du continent africain (Somalie, Burundi, Mozambique, Tanzanie) et Madagascar, c’est un système régional qui existe, dans lequel est fortement imbriqué Mayotte. C’est une chance, à condition de prendre le parti de la coopération et du développement régional. En matière d’économie, d’infrastructures, d’échanges, il y aurait énormément à faire. Encourager par exemple le développement des Comores, particulièrement dans des secteurs qui peuvent être stratégiques, cela pourrait être une voie vertueuse. C’est d’ailleurs une des voies proposées par la Cour des comptes en 2022, en recommandant alors de « concevoir le développement à long terme de Mayotte en prenant en compte son intégration dans son environnement régional ». Elle pointait en même temps le désintérêt de la métropole pour l’archipel : « les services de l’État sont fragilisés par des effectifs taillés au plus juste, en méconnaissance de difficultés sans commune mesure avec celles rencontrées en métropole. Les services de la préfecture, notamment, sont trop mobilisés par les urgences successives pour assurer l’impulsion et la coordination nécessaires au développement de l’archipel ». Don’t acte.
Cette question de l’immigration est au centre de l’avenir de Mayotte. Il faut y répondre avec justesse et mesure, et non avec la matraque et le ton martial. Plutôt que l’abandon du droit du sol, une blessure intime pour notre République, il nous faut partir de ce qui existe et troquer le logiciel « métropolitain » contre celui, bien plus nuancé, de l’archipel. Très souvent, l’immigration est visée pour son effet sur l’insécurité. Les prisons de Mayotte ne sont pourtant pas peuplées que d’immigrés ! C’est la pauvreté qui sape le développement de l’archipel, dans toutes ses dimensions. Faire de l’immigration la clé de tous les problèmes, c’est refuser de voir sa propre responsabilité.
J’ai entendu mille témoignages sur l’insécurité qui rend la vie insupportable sur l’île.
Des « coupeurs de routes » qui dépouillent les habitants la nuit aux pillages pour subvenir aux besoins essentiels en passant par les violences, les trafics (parfois de bouteilles d’eau !) et les affrontements entre bandes, c’est un sujet qui structure la vie quotidienne à Mayotte. J’ai pu constater une forte présence de policiers et de gendarmes, sans doute corrélée à la situation post-cyclone, et j’ai pris le temps de longs et précieux échanges avec eux. Beaucoup d’entre eux sont venus par choix. J’ai pu observer aussi leurs échanges avec les habitants, notamment des jeunes de la Vigie, et j’ai constaté beaucoup d’intelligence et de respect dans les postures et les discussions. Ces rencontres m’ont convaincu que l’amalgame récurrent entre l’immigration et l’insécurité nous empêche de voir l’éléphant dans la pièce : c’est la pauvreté, l’économie informelle et les privations qui génèrent l’insécurité. Refuser de voir cette réalité, c’est ne pas être outillé pour y répondre.
Je garde un souvenir très fort d’une soirée passée avec une ONG à distribuer des préservatifs à des prostituées, pour la plupart Malgaches, et à échanger avec elles . Ces femmes incarnent d’une certaine manière ce croisement entre la pauvreté, l’économie informelle et l’insécurité. Elles témoignent du dénuement qui pousse à s’affranchir de toute règle pour ne serait-ce que « s’en sortir ». Cette philosophie, je l’ai retrouvée souvent lors de mon séjour, dans des contextes très différents. Pendant longtemps, cette économie informelle a arrangé tout le monde ou tout le monde s’est arrangée avec. C’est par exemple l’importation et l’utilisation massive de produits phytosanitaires interdits, qui génère des pollutions et une mise en danger pour les habitants. Ou encore la vente de produits alimentaires sur les bords de route. C’est les trafics, commerces et activités non déclarés pour échapper aux taxes, dont le fameux « octroi de mer », qui s’impose aux produits importés.
Est-ce que Mayotte est condamnée à ces inégalités, à cette insécurité, à cette pauvreté galopante ? Certainement pas. En prenant le parti de la coopération régionale, en établissant un plan concret pour transformer cette économie informelle en un économie organisée et coopérative, on pourrait inverser la tendance. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur l’Économie Sociale et Solidaire, mes échanges avec la CRESS (chambre régionale de l’ESS) m’en ont convaincu. Pour certaines filières, cette structuration est déjà à l’œuvre, avec succès : je pense notamment à la filière avicole ou à celle, émergente, du lait. En passant d’une économie informelle à des activités déclarées qui garantissent des revenus, il est possible de créer un contexte économique favorable au développement des Mahorais. J’ai pu voir les débuts prometteurs de cette tendance, mais il faut absolument que l’Etat soit présent pour accompagner cette dynamique et ne pas la laisser se faire écraser par les effets du cyclone.
Cela suggère de prendre également le pli d’un développement accolé aux services publics et aux droits. La quasi-absence de centres de recherche, de lieux de formation en nombre suffisants (par exemple les Centres de Formation des Apprentis), la fragilité des infrastructures de base, des moyens de mobilité… tout cela crée un territoire appauvri dans tous les sens du terme. C’est à cela que nous devons remédier pour que puisse se construire et se reconstruire l’archipel mahorais. C’est donc le sens que doit prendre la reconstruction de l’archipel. Cela fera l’objet d’une troisième (et dernière) note en vue de la prochaine loi-programme pour Mayotte, pour voir quels enjeux, quelles ambitions et quelle planification peuvent être en ligne de mire.
La crainte d’un retour à l’état initial appelle en urgence à une mobilisation maintenue et même amplifiée en faveur des mahorais et mahoraises.